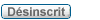Citer:
Le déclin des tueurs en série américains
Pourquoi le nombre de tueurs en série, qui avait explosé dans les années 1980, est en baisse, ainsi que la fascination qu'ils exercent
En matière de meurtres en série, Stephen Griffiths a tout fait dans les règles de l'art. Il a ciblé des prostituées dans les bas-fonds de Bradford, une ville du nord de l'Angleterre. Il a choisi une arme du crime singulière: une arbalète. Il a affirmé avoir mangé des bouts de ses victimes – deux en les cuisant, et l'une crue. «Je suis misanthrope», a-t-il déclaré aux enquêteurs de la police, quand il fut enfin arrêté en 2010. «Je n'ai pas trop de temps à perdre avec l'espèce humaine.» Devant le tribunal, il s'est de lui-même présenté comme le «cannibale à l'arbalète.» Comme s'il connaissait la science du meurtre en série sur le bout des doigts. (Et c'est le cas: Griffiths avait commencé un doctorat à l'Université de Bradford, et y étudiait la criminologie.). Et pourtant, malgré tous ses efforts, il n'a eu le droit qu'à un petit entrefilet dans le New York Times au moment de sa condamnation, le mois dernier.
Les tueurs en série ne font tout simplement plus autant sensation qu'avant. Évidemment, ils n'ont pas disparu. Le mois dernier, la police du comté de Suffolk, dans l’État de New-York, a découvert les corps de quatre femmes jetés près d'une plage de Long Island. La police de Philadelphie a attribué les meurtres de trois femmes près de la ville de Kensington à un unique «étrangleur de Kensington». Mardi, à Flint, dans le Michigan, un poignardeur en série présumé a plaidé la folie.
Mais le nombre de meurtres en série semble en diminution, tout comme la fascination du public à leur égard. «Il semble en effet que l'âge d'or des tueurs en série soit visiblement passé», déclare Harold Schechter, professeur au Queens College de l'Université de la Ville de New York et spécialiste du crime.
Chiffres
Les statistiques des meurtres en série sont difficiles à obtenir – le FBI ne conserve pas de tels chiffres, selon un porte-parole – mais les données en notre possession suggèrent que les meurtres en série ont connu leur apogée dans les années 1980, pour décliner depuis. James Alan Fox, professeur en criminologie à l'Université de Northeastern et co-auteur d'Extreme Killing: Understanding Serial and Mass Murder [Meurtre extrême: comprendre les meurtres en série et les meurtres de masse] tient une base de données listant tous les meurtres en série attestés depuis 1900. Selon ses chiffres, fondés sur des coupures de presse, des livres et des sources Internet, il n'y avait qu'environ une douzaine de tueurs en série aux États-Unis avant 1960. Puis les meurtres en série ont décollé: ils étaient 19 dans les années 1960, 119 dans les années 1970 et 200 dans les années 1980. Dans les années 1990, le nombre de cas est redescendu à 141. Et les années 2000 n'ont vu agir que 61 tueurs en série. (La définition du «meurtre en série» varie, mais pour Fox, il s'agit d'une suite de «quatre homicides ou plus, perpétrés par un ou quelques criminels, qui s'échelonnent sur une durée de plusieurs jours, mois, voire années.» Pour éviter de les compter deux fois, il affecte les tueurs dans les décennies correspondant au milieu de leur carrières.)
Il existe de nombreuses explications structurelles à cette hausse des meurtres en série signalés dans les années 1980. La collecte de données et la conservation des archives se sont améliorées, rendant plus facile la découverte de cas de meurtres en série. Les forces de l'ordre ont aussi développé des méthodes d'enquête plus sophistiquées, permettant aux policiers de faire des rapprochements entre plusieurs affaires – tout particulièrement entre les États – qu'ils auraient autrement ignorés. L'obsession grandissante des médias pour les tueurs en série dans les années 1970 et 1980 a peut-être aussi créé un petit effet boule de neige, offrant un accès facile à la célébrité.
Mais ces facteurs n'expliquent pas le déclin des meurtres en série depuis 1990. Au contraire, ils le rendent encore plus significatif. Pourquoi donc une telle tendance à la baisse? Difficile à dire. Une amélioration des services de police pourrait jouer un rôle, les tueurs en série en herbe étant arrêtés dès leur premier crime. Idem avec la hausse des incarcérations, pour Fox: «Ils sont peut-être encore derrière les barreaux.» Quoiqu'il en soit, le déclin des meurtres en série colle avec une baisse remarquable du nombre global des crimes violents depuis les années 1980. (Attention cependant: les chiffres des années 2000 peuvent peut-être fausser ces résultats, vu que certains tueurs en série n'ont pas encore été arrêtés.)
Intérêt médiatique
Et avec des statistiques en baisse, l'empressement des médias s'est tari. Certes, vous avez encore de temps en temps des snipers de Washington ou un «sinistre endormi» pour terroriser une communauté. Mais rien, ces dix dernières années, n'a captivé l'inconscient collectif comme l'ont fait les pervers sexuels et les psychopathes des années 1970 et 1980, que ce soit Ted Bundy (faisait semblant d'être blessé pour gagner la sympathie de femmes qu'il tuait ensuite; environ 30 victimes), John Wayne Gacy (entreposait des cadavres dans les vides sanitaires de son plafond; 33 victimes), ou Jeffrey Dahmer (gardait des restes humains dans ses placards et son congélateur; 17 victimes). Ces crimes ont généré des emballements médiatiques en partie parce qu'ils puisaient dans les obsessions et les peurs de l'époque: Bundy, un golden boy membre de l'équipe de campagne présidentielle de Nelson Rockefeller, à Seattle, semblait exposer la part d'ombre cachée derrière le visage enjoué de l'Amérique. Gacy, qui se déguisait en clown et s'attaquait à des adolescents était le cauchemar de tous les parents. Le «Fils de Sam», David Berkowitz, s'est nourri – et l'a ainsi tourné en ridicule- de l'obsession médiatique envers les tueurs en série en envoyant une lettre au journaliste du New York Daily News, Jimmy Breslin.
Les médias ont rendu la politesse, en amplifiant l'impression que les tueurs en série étaient partout, rabâchant les fausses statistiques faisant état de 5.000 victimes de tueurs en série chaque année. Ces histoires épouvantables n'étaient pas vraiment refroidies par le FBI, dont l'un des agents inventa le terme de «tueur en série» en 1981. (Le terme de «meurtrier en série» est apparu pour la première fois en 1961, dans un article sur le film de Fritz Lang, M. le Maudit, selon l'Oxford English Dictionary.) L'impression d'une épidémie de meurtres en série a aussi présidé à la création par le FBI, en 1981, du National Center for the Analysis of Violent Crime [Centre national pour l'analyse des crimes violents].
Illustres meurtriers
Les crimes sordides ont toujours piqué au vif les angoisses de leur temps. Le meurtre d'un garçon de 14 ans par les étudiants à l'Université de Chicago, Nathan Leopold et Richard Loeb, en 1924, a capté l'obsession grandissante envers la psychiatrie moderne, vu que les deux compères se considéraient comme les parfaits exemples du surhomme nietzschéen, libres de toute servitude morale. Une série d'enlèvement d'enfants dans les années 1920 et 1930, en passant par les meurtres du poulailler de Wineville ou l’assassinat du fils de Charles Lindbergh sont devenus les symboles de la décadence de la société durant la Grande Dépression. Charles Manson, instigateur du meurtre de Sharon Tate et de ses amis, a incarné une révolution sexuelle qui avait mal tourné. Le massacre de Columbine a exploité les peurs parentales sur les effets des jeux vidéo et des films violents.
Inversement, les crimes sensationnels qui ne s'insèrent pas dans une historiographie sociétale plus large disparaissent avec le temps. En 1927, Andrew Kehoe fit exploser trois bombes dans une école de Bath Township, dans le Michigan, tuant 38 enfants et 7 adultes, Kehoe inclus – l'une des plus importantes affaires de terrorisme national, avant les attentats d'Oklahoma City en 1995. Le désastre fit les gros titres, mais fut vite éclipsé par le vol transatlantique de Charles Lindbergh. «C'était un crime trop en avance sur son temps», déclare Schechter.
En effet, si quelque chose comme le massacre de Bath se produisait aujourd'hui, son retentissement serait probablement bien plus important que dans les années 1920. Ce que les kidnappeurs d'enfants étaient aux années 1920, les tueurs en série l'étaient pour les années 1970 et 1980 – et les terroristes le sont pour ce début de 21ème siècle. Après le 11 septembre, la crainte du délitement social a été remplacée par la peur des avions, des bombes, et de l'anéantissement massif instantané. Stephen Griffiths n'est pas le nouveau Jeffrey Dahmer. Le terroriste de Times Square, oui.
Christopher Beam
Traduit par Peggy Sastre
http://www.slate.fr/story/32575/tueurs-en-s%C3%A9rie-am%C3%A9ricainsLa criminalité, comme le reste, serait donc aussi en lien avec son époque, les "phénomènes de mode" et une sorte de "mentalité globale" d'une certaine population à un moment donné ?... Je trouve ça assez fascinant comme observation, en tout cas...