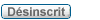Citer:
Les pensées viennent en marchant
Comme l'avaient pressenti les philosophes depuis l'Antiquité, la marche favoriserait la concentration.
Sébastien Bohler
«Les seules pensées valables viennent en marchant » écrivait Nietzsche. Comme bien des philosophes, le penseur de Weimar a souligné les vertus de la marche qui libère l'esprit alors que la posture assise, selon lui, est une faute contre l'esprit. Au point de condamner Flaubert et son idéal sédentaire (« On ne peut penser et écrire qu'assis »), et de se rallier à l'idéal rousseauiste de la marche qui « met l'esprit en mouvement ». Ils sont nombreux à s'y être essayés, des surréalistes qui tentèrent d'écrire en marchant, jusqu'à Jean Giono qui recommandait cet exercice comme forme d'hygiène de pensée. Bien avant eux, rappelons-nous qu'Aristote enseignait en déambulant, ce qui valut à son École le qualificatif de péripatéticienne (l'école des promeneurs).
La marche est liée à l'histoire de la pensée. Quels sont donc ses effets sur le cerveau ? Pour le savoir, Sabine Schäfer et ses collègues, de l'Institut Max Planck de Berlin, ont demandé à des enfants et à des adultes de passer des tests assis devant un bureau, ou en marchant à la vitesse de leur choix sur un tapis roulant. Ces tests évaluaient surtout l'attention ; ils consistaient à écouter des séries de chiffres prononcés par un haut-parleur, et à indiquer, pour chaque chiffre, s'ils l'avaient déjà entendu quatre chiffres plus tôt.
Dans ces conditions, les participants, quel que soit leur âge, ont commis moins d'erreurs en marchant, les enfants de neuf ans tirant le meilleur bénéfice de cet exercice, avec presque 40 pour cent d'erreurs en moins.
Selon les psychologues, ce phénomène s'explique par un effet de vigilance : la marche maintient le corps en action et, dans une certaine mesure, l'esprit alerte. Le cerveau est mieux irrigué, l'attention se relâche moins facilement. Scientifiquement, Nietzsche aurait ainsi eu le dernier mot face à Flaubert, mais ce dernier aurait pu lui rétorquer qu'entre adultes, l'effet est assez faible et que ce sont surtout les enfants qui ont intérêt à marcher pour réfléchir.
Il aurait eu en partie raison, car les tests utilisés dans cette étude évaluent la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à maintenir une information active en mémoire pendant quelques secondes ou minutes, afin de l'utiliser dans un raisonnement. Or, les écrits de Nietzsche révèlent qu'il souffrait peut-être de difficultés dans ce registre, le philosophe se plaignant de pensées qui lui échappaient, ou d'idées qu'il n'arrivait pas à maintenir assez longtemps à sa conscience pour les développer pleinement – ce qui expliquerait son goût pour les aphorismes.
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-les-pensees-viennent-en-marchant-24643.phpJe me rappelle que plus jeune, en effet, j'avais tendance à marcher de long en large pour apprendre quelquechose par coeur...