Les variations du méthane de l’atmosphère martienne inexplicables actuellement Les variations de méthane atmosphérique apparemment observées dans certaines régions de la planète (Selon la dernière définition de l'Union astronomique internationale (UAI), « une planète est un corps céleste (a)...) Mars contredisent notre connaissance de la physique (La physique (du grec φυσικη) est étymologiquement la Science de la nature. Son champ...) et chimie (La chimie est la science qui étudie la composition et les réactions de la matière.) de l’atmosphère. C’est ce que viennent de démontrer deux chercheurs CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de...) appartenant à des équipes INSU-CNRS1. Les chercheurs ont simulé l’évolution du méthane avec un modèle numérique 3D de l’atmosphère de Mars. Ils ont ainsi montré que la chimie atmosphérique telle que nous la connaissons n’autorise pas de variation détectable du méthane sur Mars, même dans le cas d’une source locale ou saisonnière. Pour reproduire les observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide...), il est nécessaire de disposer d’une source de méthane 600 fois plus forte que si le méthane était mélangé, mais également d’un processus atmosphérique de destruction 600 fois plus rapide. Si la destruction du méthane survient au niveau du sol, celle-ci doit s’effectuer en 1 heure (L'heure est une unité de mesure

, d’où un environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se...) extraordinairement hostile pour la survie de molécules organiques sur Mars. Des nouvelles mesures sont donc indispensables pour mieux comprendre la chimie du méthane martien. Cette étude est publiée dans la revue Nature du 06/08/2009.
Sur Terre, plus de 90% des émissions de méthane dans l’atmosphère sont d’origine biologique. La détection de traces de méthane sur Mars par la sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système...) européenne Mars Express (Mars Express est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a pour objectif l'étude de...) (ESA) en 2004 avait donc relancé l’hypothèse d’une vie présente ou passée à la surface (Il existe de nombreuses acceptions au mot surface, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, souvent...) de la planète, même si les faibles quantités mesurées (environ 50 000 fois moins que sur Terre) peuvent également résulter d’une source géologique. Un aspect surprenant de cette découverte est que le méthane martien varie avec la saison (La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. D'une durée...) et présente de fortes concentrations localisées, comme semblent le montrer des observations télescopiques récemment publiées en janvier 2009. Du fait de sa durée de vie théorique de plus de 300 ans, on s’attend pourtant à ce que le méthane soit mélangé de façon homogène par la circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.) atmosphérique.
En utilisant un modèle de circulation générale qui inclue la photochimie du méthane, les chercheurs ont montré que la photochimie telle que nous la connaissons ne produisait aucune variation mesurable du méthane sur Mars. En revanche, la condensation et sublimation du gaz (Au niveau microscopique, on décrit un gaz comme un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi...) carbonique aux régions polaires peuvent conduire à des variations importantes de méthane, mais celles-ci diffèrent notablement de celles observées. Pour obtenir une évolution spatiale et saisonnière compatible avec les observations, il est calculé que le méthane doit être émis dans des quantités comparables à celles produites par hydrothermalisme sur l’ensemble de la dorsale médio-atlantique, une importante source géologique de méthane sur Terre. Une telle production est surprenante sur une planète aride et au volcanisme dormant (Dormant) comme Mars. Par ailleurs, ce méthane doit être détruit en environ 200 jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux...) terrestres dans l’atmosphère. Ce résultat implique l’existence d’un processus de destruction inconnu, rapide, et particulier à Mars. De plus, il ne doit pas affecter les autres espèces chimiques observées dans l’atmosphère de la planète (ozone, peroxyde d’hydrogène, ou monoxyde de carbone) pour lesquelles un bon accord est généralement observé avec les modèles. L’hypothèse récente d’une destruction électrochimique du méthane dans les tempêtes de poussière, testée dans l’étude, ne semble pas répondre à cette dernière condition. Une autre éventualité est que le méthane soit détruit au contact du sol martien. Dans ce cas, il est montré que cette perte doit intervenir en environ 1 h pour expliquer les observations. L’existence d’un processus aussi rapide dans le sol martien est aujourd’hui difficilement explicable. Le prochain rover Mars Science Laboratory (2011) permettra d’étudier cette énigme en effectuant les premières mesures in situ du méthane sur Mars. La surveillance du méthane martien se poursuivra avec le Mars Science Orbiter prévu en 2016, puis par le rover européen Exomars (ExoMars est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne prévue pour 2013 dans le cadre du Programme...).







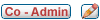
 Sage à ses heures, idiot le reste du temps.
Sage à ses heures, idiot le reste du temps.