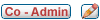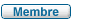Ar Soner a écrit:
J'ai lu l'article de sociologie des risques et j'avoue ne pas être d'accord avec ce qui y est écrit, tant sur le fond que sur la forme.
J'avoue être un peu déçue (pas déçue de ta personne, cela va de soi, mais déçue que cette vision des sciences humaines ne semble pas t'avoir apporté ne serait-ce que quelques éléments que tu aurais pu juger intéressants).
Citer:
Je serais curieux de voir la source de l'histoire de la confrontation entre éleveurs du Cumbria et scientifiques suite au passage du « nuage de Tchernobyl »... car telle que racontée dans l'article, celle-ci me semble un peu cousu de fil blanc et je suspecte que la réalité ne soit plus complexe que le résumé qui en est fait ici (« les savants qui arrivent drapés dans leur suffisance et qui se vautrent car ils n'ont pas su écouter le bon sens paysan »).
C'est vrai que la source n'est pas énoncée tout à fait clairement dans cette partie, mais elle me semble être là tout de même. Je crois en effet comprendre que l'auteure se réfère principalement aux travaux de
Brian Wynne et, si j'en crois Wikipedia, notamment sa contribution au livre
Risk, Environment and Modernity (1996), mais aussi à son article “Une approche réflexive du partage entre savoir expert et savoir profane”,
les Cahiers de la sécurité intérieure, n°38, 1999 qui, pour le coup, est bien cité dans le texte.
Cela dit, n'ayant pas lu lesdites sources, je ne sais pas si le résumé qu'en fait l'auteure du billet est fidèle au contenu, en effet. Ce serait donc à vérifier à l'occasion. Une chose est sûre en tout cas: tu as raison de noter que le ton employé pour retranscrire les constats de Wynne n'est pas anodin du tout dans cette partie du récit.
Citer:
En fait, je le suspecte car j'ai personnellement vécu une situation similaire: j'étais du côté des scientifiques, et (...) conséquente (un bon tiers au bas mot) a quand même considérée que nous ne les avions pas pris au sérieux, que nous les avions pas assez écouté... Je pense très sincèrement que nous intervenions dans un contexte difficile pour les exploitants, et qu'étant associés à « l'institution/administration/instances officielles » (avec lesquelles nous n'avions pourtant rien à voir), nous avons pris pour tous les autres et avons servi de réceptacle à la frustration et la colère
De mon point de vue, ton récit est intéressant précisément parce qu'il montre justement à quel point tout cela est politique et subjectif au fond (soit exactement ce que tente de démontrer l'article)... et cela autant du côté des agriculteurs mécontents que du tien (de mon point de vue - lui même subjectif - en tout cas).
En effet, tu sembles postuler d'emblée qu'il va de soi que "ménager la chèvre et le chou" (je reprends ici tes mots) aurait naturellement été ce qu'il y avait de plus rationnel/pragmatique/raisonnable à faire, ce qui pourrait déjà alimenter une première discussion en soi (et je le dis alors même que je suis plutôt d'accord avec toi dans le fond). Mais surtout, on voit bien que l'énoncé "ménager la chèvre et le chou" impliquait d'emblée - pour les uns (scientifiques) comme les autres (agriculteurs) - de devoir sacrifier des "choses" en cours de route. Tout ce qui s'en est suivi était donc
nécessairement du rapport de force, de la négociation, et donc, du politique. C'est la fameuse couverture que chacun essaie de tirer à soi et c'est humain.
De ton côté, tu sembles en fait dire entre les lignes que, pour toi, satisfaire le plus grand nombre va de soi, que c’était essentiel et que trouver des compromis acceptables pour la majorité était le plus important pour le "vivre ensemble" (tu ne le dis pas comme ça dans ton message, alors tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois comprendre que c'était quand même bien l'idée). Et je suis politiquement tout à fait d'accord avec toi, en plus. Mais une fois cela posé, il faut bien se dire que ce n'est pas la visée de tout le monde et que d'autres se foutent pas mal du « commun ». Or, celles et ceux qui sont plus individualistes et/ou en dehors du compromis ont eux
aussi des raisons très rationnelles et pragmatiques d'agir et de penser comme ils le font, même si je ne suis pas politiquement d'accord avec eux. En gros, c'est entre autres une question de valeurs et de finalités.
Et je pense que derrière tout ça se cache aussi la vaste question (éminemment politique également) de la hiérarchisation des causes: à l'évidence, l'équipe de scientifiques dont tu faisais partie n'avait tout simplement pas les mêmes cadres de réflexion ni même les mêmes visées et priorités que les agriculteurs et cela explique aussi les désaccords que tu sembles décrire. Si la priorité des agriculteurs semblait légitimement économique, votre priorité à vous, scientifiques, était - tout aussi légitimement - de mettre en place un protocole viable(*) et de faire avancer la science. Ici, je ne vois rien qui ne soit pas respectable d'un côté comme de l'autre. Mais ces deux desseins différents nécessitaient en effet inévitablement des arbitrages.
(*)D'ailleurs, tu ne précises pas le type d’expérimentation dont il était question, ni qui commanditait l'étude, ou encore pourquoi et dans quel contexte elle était demandée, ce qui fait qu'on manque de pas mal d'éléments importants pour se faire un réel avis sur ce que tu racontes au final. Mais note que je n'attends pas de réponse à ces questions, d'abord parce que je pense que je le sais plus ou moins, mais aussi et surtout parce que je comprends bien que tu ne souhaites pas donner trop de détails pour des raisons évidentes d'anonymat. Ma remarque est en fait juste rhétorique et vise simplement à montrer que ces choses que tu ne précises pas sont pourtant aussi éminemment politiques. Car je suppose que ces exprimentations ne partaient pas de rien et ne se sont pas faites
ex nihilo un beau matin juste parce qu'une équipe de scientifiques s'est dit que ça pourrait être rigolo ou intéressant de le faire (les budgets ainsi que le temps alloués à la recherche ne permettent malheureusement plus ce genre de scénarios très sympathiques). Du coup, je suppose qu'il y avait des raisons bien particulières à l'origine de cette demande et ne pas les connaître ne permet pas de peaufiner son point de vue.
Bref, par écrit, ce n'est pas toujours simple d'exprimer ses pensées, du coup je ne sais pas si je suis parvenue à faire passer clairement ce que je voulais dire? Mais pour faire simple, à te lire, j’ai pu avoir l’impression, lorsque tu racontais ton anecdote, que tu pensais que ta démarche et celles de tes collègues était évidemment rationelle, pragmatique et juste (et donc bonne - pour ne pas dire "la meilleure") et que vous avez eu le sentiment d’être tombés sur un bon tiers de retors quant à eux pas très rationnels (et donc, dans l'erreur)... ce qui est une description à laquelle je ne souscris pas pour toutes les raisons que je viens d’évoquer.
Citer:
Bref. Je ne dis pas que le compte-rendu qui est fait de l'affaire est forcément faux (il y a des scientifiques qui méprisent tous ceux qui n'ont pas de doctorat), mais je voudrais aussi être sûr qu'on n'est pas en train de se forger une opinion du règne du roi Arthur en allant demander leur avis à Roparz et Guethenoc*.

C’est là en fait un des nœuds du débat et là que c’est un peu délicat. Car si je suis tout à fait d’accord avec toi pour dire qu’il y a des avis moins valides que d’autres, je précise d’emblée – quant à moi – « moins valides à mes yeux » : ce disant, je reconnais que je les trouve moins valides par rapport à des valeurs et critères qui me sont propres et qui peuvent être questionnés. On a déjà eu une discussion un peu similaire par le passé mais, par exemple, la « vérité » - qui est déjà, en soi, une notion toute relative - n’intéresse pas tout le monde de la même façon et tout le monde n’y attache pas autant d’importance. On peut le déplorer (ou pas), mais c’est un fait. Et justement, choisir de le déplorer ou non, est aussi politique en soi. Tu vas dire que je me répète mais on nage toutes et tous constamment au milieu de tout un tas de subjectivités.
Par exemple, lorsque tu écris que certains scientifiques méprisent ceux qui n’ont pas de doctorat et que ce n’était pas votre cas, je suis prête à mettre ma main au feu que tu es sincère (j’allais écrire « que tu dis vrai », mais j’ai justement corrigé à cause de ce qui va suivre). En gros, si j’avais été présente, il est fort probable que j’aurais vu les choses telles que tu les décris et que j’aurais été absolument d’accord pour dire qu’il n’y avait pas le moindre mépris dans votre attitude. Mais si dans le même temps quelqu’un d’autre avait dit s’être senti méprisé, j’aurais essayé de comprendre pourquoi. Parce que j’estime que je n’ai pas le droit de nier les ressentis des autres, même s’ils ne recoupent pas les miens. Et ce n’est pas parce qu’ils ne recoupent pas les miens qu’ils sont pour autant des mensonges ou des
erreurs. Là encore, tout est toujours une question de point de vue.
Pour résumer en une idée toute bête, mais à laquelle je tiens : il n’y a pas, pour moi, de récit qui soit absolument vrai d’un côté et de récit qui soit absolument faux de l’autre : il y a des récits différents et que l’on peut juger plus au moins valables et/ou plausibles en fonction de tout un tas de facteurs (le modèle de société que l’on souhaite, nos expériences et connaissances, le cadre de référence qui est le nôtre, nos visées, nos opinions, nos valeurs, etc.). En gros, on choisit les paroles auxquelles ont souhaite accorder plus d’importance et c’est totalement politique, ça aussi.
Ici, en l’espèce, et pour en revenir au contenu de l’article, il est expliqué que les éleveurs de Cumbria ne se sont pas sentis écoutés par les scientifiques, au point que c’est quelque chose qu’ils ont tenu à verbaliser auprès de chercheurs en sciences sociales, qui ont ensuite relayé telle quelle et au premier degré cette parole dans leur étude – ce qui est un parti pris, bien sûr. Mais de ton côté, en choisissant de minimiser cette parole au motif qu’il se pourrait bien qu’elle soit exagérée, tu fais aussi un choix (et tu en as absolument le droit, évidemment !) qui demeure au même titre un parti pris qui n’engage que toi dans toute ta subjectivité. Ou alors, il faudra me dire précisément sur quels critères objectifs on peut se baser dans un tel contexte pour décider que telle parole vaut mieux que telle autre. Personnellement, je ne sais pas puisque seul un critère vrai/faux m’aurait semblé à même de le faire et, en l’occurrence, j’ai tenté de montrer précédemment que ce critère vrai/faux était trop relatif et dépendant de tout un tas de facteurs* (eux-mêmes discutables, qui plus est) pour que l’on puisse s’y fier (* ces facteurs pouvant être aussi vastes que les personnes en présence, les territoires, les moments, etc. dont il est question).
Pour le dire autrement, considérer qu’un point de vue est plus ou moins valable qu’un autre, c’est déjà se trouver dans le rapport de force et la domination (ce qui n’est pas interdit et n’est pas une honte. Strictement personne n’y échappe et c’est en plus nécessaire bien souvent. Reste qu’il faut juste – à mon sens - en avoir conscience).
Citer:
- j'ai l'impression que l'article occulte toute la littérature scientifique sur
la gestion des risques, qui a produit un bon paquet d'indicateurs et d'outils visant justement à quantifier lesdits risques. Du coup, l'affirmation selon laquelle on ne saurait pas évaluer objectivement un risque réel me laisse songeur...
Etant loin d’être une spécialiste de ces questions, je ne vais pas pouvoir argumenter aussi rigoureusement que je le voudrais, mais je pense quand même pouvour apporter un ou deux éléments de réflexion en réponse.
Je suis allée voir la page Wikipedia que tu as donnée sur la gestion des risques. Et ce qui m’a frappée en premier lieu, ce sont les sources assez ciblées et redondantes qui apparaissent dans la bibliographie. En l’occurrence, on voit plusieurs publications de l’AFNOR, dont je rappelle qu’elle a des activités commerciales, et donc lucratives (ce qui n’est pas discréditant en soi, bien entendu, mais qui doit quand même être relevé car ça ne me semble pas anodin dans ce contexte) et qui se trouve également être une organisation fortement ancrée dans les sphères du pouvoir (cf. les wikis de l’AFNOR et du groupe AFNOR). Même chose ici, ce n’est pas discréditant en tant que tel, mais il est bien évident que ce sont quand même des éléments qu’il faut avoir en tête pour la réflexion. On trouve aussi plusieurs sources bibliographiques qui semblent traiter du management des risques (or, le management n’est pas, par essence, une discipline à caractère franchement social) ainsi que des sources émanant plutôt des sciences dures et de l’ingénierie... Mais on n’y voit justement aucune publication de sciences sociales (dites moi si j’ai la berlue ou que je me trompe, je rectifierai).
D’où ma question : au nom de quoi et sur la base de quels critères juges-tu que ces publications vaudraient forcément mieux que les lectures que les sciences sociales auraient à offrir sur ces questions ? Ne pourrait-on pas imaginer que ces dernières aient aussi quelque chose à apporter ?
En l’occurrence, je pense quant à moi qu’une partie des sciences sociales pourrait entre autre expliquer (bien mieux que je ne saurai le faire ici) qu’il faut toujours regarder comment sont crées les organismes et institutions et comment ils fonctionnent afin d’en déduire d’éventuels jeux de pouvoir et d’intérêts.
Bref, en un mot comme en 100, aborder la question de la gestion des risques uniquement à l’aune de ce qu’en dit l’AFNOR et de ce qu’en pensent les acteurs du management et les sciences "dures" me semblerait quant à moi un poil réducteur voire même peut-être un peu naïf (mais là encore, j’admets bien volontiers que c’est un point de vue complètement situé et politique).
Citer:
Je pense plutôt que le problème est le même que pour les statistiques : notre science des statistiques est très aboutie, mais sa production est malheureusement presque complètement incompréhensible à des non-statisticiens (soit la très grande majorité de la population). D'où le besoin d'avoir des experts qui puissent interpréter et rendre intelligibles ces résultats.
Que notre science des statistiques soit aboutie est une chose et je veux bien te croire. Je ne maitrise pas bien le sujet et m’en remets donc à ton expertise là-dessus. Mais là encore, je ne peux m’empêcher de me dire que les stats ne sont pas faites
ex nihilo et que tout chiffre donné par elles est forcément la résultante de choix initiaux et d’arbitrages qui n’engagent que leurs commanditaires ou leurs auteurs. Par exemple: sur quel(s) territoires choisit-on de travailler lorsque l’on fait des stats ? Pourquoi sur telle tranche d’âge plutôt que telle autre ? Que cherche-t-on à montrer et quel est le postulat de départ ? etc.
Ici, à nouveau, c’est le cadre global dans lequel les choses sont faites qu’il faut interroger et questionner. En disant cela, je ne dis pas du tout que les statistiques ne valent rien. Je dis juste qu’elles sont, comme tout le reste, toujours dépendantes de tout un tas de choix et de facteurs plus ou moins aléatoires selon les cas et qu’elles ne peuvent donner à voir qu’une petite partie de la réalité. S’en servir me semble indispensable et précieux mais, comme toujours, en les considérant avec une « juste » distance (et là encore, on pourrait débattre à l’infini sur ce que serait une « juste distance »).
Citer:
- le fait qu'un gouvernement ou qu'une institution puisse instrumentaliser ou manipuler les risques ne signifie pas forcément que la gestion des risques est à balancer à la poubelle. Comme l'a dit Cortex à de nombreuses reprises : ce n'est pas parce qu'un malade utilise un marteau pour commettre des meurtres sauvages, que pour autant le marteau cesse d'être un outil utile et efficace en de bonnes mains.
Même chose ici. Je ne sais pas ce que seraient « de bonnes mains » ou de « mauvaises mains » dans l’absolu. Pour filer ta métaphore : si je me sers d’un marteau (dont je suis évidemment d’accord pour dire qu’il est un outil utile et efficace) pour neutraliser et tuer un individu qui était lui-même en train de tuer un-e proche,
jugeras-tu que ledit marteau se trouvait entre de bonnes ou de mauvaises mains ? Ma question est ici rhétorique, je n’attends pas de réponse. C’est surtout encore une fois pour montrer que bon/mauvais, vrai/faux sont des polarités qui ne me parlent pas et que la réponse à cette question est, encore une fois complètement politique (oui, je sais, je suis usante à répéter cela sans arrêt mais je ne parviens pas à voir les choses autrement) et dépend de tout un tas de choses.
Citer:
- De même, les gens sont libres de refuser le nucléaire s'ils estiment que la balance bénéfice/risque n'en vaut pas la peine... mais il faut qu'ils en assument ensuite les conséquences (à savoir : avoir une électricité beaucoup plus chère et plus polluante, avec tout ce que ça implique).
Je suis bien entendu d’accord avec toi, mais note que c’est tout aussi valable pour les pro-nucléaire qui devront par exemple assumer le néocolonialisme qu’ils imposent aux pays du sud ou encore qui se trouveront peut-être un jour en situation de devoir assumer également l’évacuation
d’un million de personnes en cas de gros pépin (= d’accident nucléaire).Bref, là encore, on en revient à des questions éminemment politiques que sont les choix et les arbitrages. Si ton argument des prix et de la pollution s’entend absolument, je suis de celles et ceux qui pensent que les arguments que je te donne en retour sont eux aussi tout à fait valables. D’où le fait qu’il soit si difficile de se faire un avis définitif sur ces sujets, du reste.
Citer:
- En revanche, pour moi, cela demande impérativement que les citoyens soient dotés d'un minimum de culture générale scientifique et d'esprit critique ; sans cela, un tel contrat social devient complètement caduque.
Et bien entendu, il
faut des experts et des données scientifiques (je persiste et signe sur ce point !).

Bien évidemment que je suis d’accord avec cela aussi. Bien sûr qu’il faut des données scientifiques et des « experts » (dont il resterait encore à expliquer et décider sur la base de quels critères on se base pour qualifier untel ou unetelle d’expert-e, mais soit). Je n’ai jamais prétendu le contraire. Je dis seulement qu’il faut que les forces et les pouvoirs soient distribués et pas aux seules mains des un-e-s ou des autres. En gros : pour moi il est évident que les citoyens et « profanes » ont
aussi beaucoup de savoirs et de compétences à nous apprendre et à faire valoir.
Citer:
La dernière partie, enfin, m'a fait soupirer assez fort. (…) Ces résultats ne sont vrais que dans la mesure où l'étude a été réalisée aux USA, pays dans lequel ce sont des hommes blancs qui tiennent le haut du pavé.
Bah disons que je ne vois pas beaucoup d’exemples de pays où se seraient les femmes (blanches ou de toute autre couleur - même s'il est évident que les femmes blanches ont l'avantage haut la main) qui tiendraient le haut du pavé. Ce n’est pas comme si les Etats-Unis étaient une exception en mettant principalement les hommes à des postes de pouvoir même si, bien sûr, on trouve aussi des femmes haut placées (et même de plus en plus, et c’est tant mieux).
Citer:
Mais une étude similaire menée chez les femmes députés de la République en Marche, chez les chefs d'états d'Afrique de l'Ouest, ou chez les PDG des grandes entreprises chinoises montreraient des résultats assez identiques, j'en suis sûr.
Petites questions en vrac : les chefs d’état d’Afrique de l’Ouest sont ils majoritairement des femmes ? Les PDG des grandes entreprises chinoises sont-ils majoritairement des femmes ? Les femmes députées sont-elles majoritaires dans les gouvernements? (Même si je suis d’accord pour dire qu’on progresse clairement sur ces questions). C’est ça, en fait, "l’image générale" (pour reprendre tes mots) et donc, pour moi, le fond du débat. Du coup, j’avoue ne pas trop saisir l’objection ?
PS : Vraiment désolée car ce message est encore beaucoup (mais vraiment beaucoup) trop long et hors de toutes proportions raisonnables… Tellement que j’ai la flemme de me relire pour corriger les coquilles et voir si je suis cohérente et m'exprime en bon français…
Mea culpa…