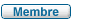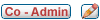Ar Soner a écrit:
Je réalise que je n'ai peut-être pas été assez précis dans les mots que j'ai choisi : lorsque je parlais de 'Français moyen', je pensais à un Français choisi au hasard dans la rue, pas à une vision caricaturale de l'homme du peuple façon Robert Bidochon. Dans ma tête, c'est une idée qui est relativement indépendante de la catégorie socio-professionnelle des gens : tu trouveras des Français moyen que tu ailles au milieu du 16ème à Paris ou dans le petit village de Boucheporn en Moselle (500 habitants). Et je m'inclue dedans : je peux moi aussi être ce Français pioché au hasard dans la rue.
Je ne suis toujours pas convaincue et j'ai toujours le sentiment qu'on est là dans la grosse caricature. Car je ne sais pas ce qu'est sensé être "le français moyen" ni comment il se définit/à quoi il est sensé se reconnaître. Autre question: si le "français moyen existe", à quoi reconnaît-on alors le "français inférieur" et le "français supérieur"? (Puisque pour qu'il y ait un moyen, il faut bien qu'il y ait des gens au dessus et en dessous, sans quoi, il n'est plus moyen).
Citer:
Partant de là, dire que « le Français moyen manque de culture et de rationalité » ne me choque pas : statistiquement, de mon expérience de la chose, c'est assez vrai. C'est comme lorsqu'on dit (essentiellement dans les milieux de gauche) que « le Français moyen est raciste » : ça me semble vrai, la majorité des Français ont effectivement internalisé une sorte de racisme. Ce n'est pas grave en soi (ça ne veut pas dire que les Français sont tous des nazis en puissance), et il y a des raisons socio-culturelles derrière ce phénomène, mais il faut en avoir conscience (et réaliser qu'on pourrait être, à son corps défendant, un de ces Français)... Ne serait-ce que pour pouvoir lutter contre cette tendance.
Si je suis tout à fait d'accord avec le constat qui voudrait que "les français sont plutôt racistes", je ne comprends toujours pas ce que vient faire le mot "moyen" ici. Il désigne pour moi nécessairement une catégorie de gens qui seraient moins éduqués que d'autres (pour les raisons que j'évoquais plus haut). Et donc une verticalité (en plus, à ce petit jeu-là, on sait très bien que ce sont les classes pop et moyennes qui perdent: Cf. par exemple le
livre de Bernard Lahire sur la question). Alors que tu le dis toi même: ce sont des travers que l'on peut retrouver partout, dans toutes les classes sociales et tous les niveaux d'éducation. En gros, pour moi, le "français moyen"
existe autant que l'opinion publique. C'est à dire pas, et je maintiens que c'est personellement une vision que je trouve élitiste, restrictive et caricaturale.
Pochon dit plus bas:
Citer:
En ce qui me concerne, j'aurais surtout tendance à penser que chacun, ou presque, dispose d'un ou plusieurs domaines de prédilection, dans lesquels il excelle.
Et je suis entièrement d'accord avec ça. Peu importe où tu es né, qui tu fréquentes, ce que tu fais ou ne fais pas, on a absolument tou-te-s des aptitudes, des compétences ou des domaines dans lesquels on est très bon. Par contre, on peut en effet être moins pertinent sur des sujets qui nous échappent. C'est bien pour ça que pour moi le concept "du français moyen qui manque de rationalité" n'existe pas. Je le redis: ça dépend de tout un tas de variables: des sujets, du contexte, des moments, etcaetera, etcaetera.
Citer:
De fait, si tu doutes du fait que « le Français moyen manque de culture et de rationalité », je te laisse faire un tour sur les commentaires de Libération.fr, ou sur n'importe quel groupe FB consacré à la politique (de manière générale) pour te convaincre du contraire. Regarde aussi les réactions de nos concitoyens vis à vis de n'importe quel sujet de société un peu épidermique : le végétarisme, la laïcité, le revenu de base... La plupart du temps, les avis qui sont donnés sont à l'emporte-pièce et basés essentiellement sur les préjugés des personnes, mais pas moins catégoriques pour autant (alors que la prudence et l'ouverture d'esprit devraient être de mise sur des sujets qu'on ne maîtrise pas).
D'abord, ce ne sont là que des échantillons on ne sait pas à quel point ils sont représentatifs. Combien de gens ne pensent pas la même chose mais ne s'expriment pas? Et là encore, je le redis: même si les commentaires dont tu parles existent bel et bien (et oui, c'est clairement le cas, ils existent), ce n'est pas pour autant qu'en les lisant je me dirai : "Oh, mon dieu, voilà que le français moyen qui manque de rationalité et est dans l'émotionnel à encore frappé". Je me dirai plutôt : "Oh, mon dieu, on n'a définitivement pas tous les mêmes priorités: on ne hiérarchise pas de la même façon et force est de constater qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs et qu'on n'a pas le cul sorti des ronces". Ce qui n'a rien à voir avec le manque d'esprit critique ou de rationalité. Car dire que c'est par manque de rationalité sous-entend que si ces gens étaient correctement informés, ils seraient
forcément d'accord... Autant te dire que je pense que c'est une erreur. Si des gens ne sont pas d'accord avec l'idée que tu (ou moi, ou Pierre, Paul ou Jacques) te fais du monde, c'est aussi parfois qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, tout simplement. Pas forcément parce qu'ils ne sont pas assez instruits (et sur ce dernier point, j'y reviens plus bas).
Citer:
Là encore, j'insiste : ce n'est pas grave, et ça ne veut pas dire qu'il faut retirer le droit de vote à tous les Français pour mettre en place une technocratie. MAIS il faut aussi regarder les choses en face... (...) pour encourager la création d'une éducation populaire qualitative histoire de hisser tout ce petit monde vers le haut (petit monde m'incluant moi-même et les catégories socio-professionnelles supérieures, je le rappelle).
Et qui définit ce "haut", comment, et sur la base de quoi?
Citer:
Ça dépend. Il y a aussi une sorte de mépris de classe inversé, qui s'exprime du bas vers le haut : le vieux cliché du bobo écolo, qui a fait des études donc est nécessairement urbain, est complètement déconnecté de toute forme de bon sens terrien et n'est pas capable de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts, en est un bel exemple.
Je parlais quant à moi d'un point très précis: je disais qu'on entend rarement des gens des classes pop ou moyennes dire que "les français moyens manquent de rationalité et sont trop dans l'émotionnel". Ou plutôt, si, je m'auto-corrige: on l'entend, en fait. Et c'est d'après-moi parce que la domination des classes sup a été tellement intégrée qu'elle semble naturelle et évidente à beaucoup de gens, et n'est finalement que peu remise en question. Ce qui donne des gens qui pensent profondément qu'ils (et que les autres) sont incompétents, ou pas aptes, parce que c'est ce qu'on leur a mis dans le crâne depuis... Toujours? Et forcément, puisque tout fonctionne selon les critères de la classe dominante, ça devient auto-réalisateur. Et j'avoue que ça me rend triste de voir que même des gens que j'ai en grande estime peuvent contribuer à ce discours.
Ar Soner a écrit:
Si la personne faisait l'effort de prendre du recul sur ses sentiments et de s'interroger sur les dynamiques sociales en jeu, de regarder des chiffres concrets sur l'économie de la redistribution des richesses, de se renseigner sur la façon dont le chômage fonctionne... il est probable qu'elle nuancerait son jugement.
Quant à moi, j'aurais plutôt écrit: si la désinformation n'était pas si répandue, si nos médias faisaient le travail correctement, si on donnait les moyens à nos écoles, à nos universités, les gens auraient de bien meilleures armes pour appréhender le monde qui les entoure. Rien à voir, donc, avec l'émotion ou le manque de rationalité: tout ça est profondément politique et lié au fonctionnement de notre société et c'est celà, à mon sens, qu'il faut pointer du doigt, et non "les gens". (Puis sérieusement, tu crois vraiment par exemple qu'un ouvrier qui fait les 3/8 chez Michelin a le luxe de "regarder des chiffres concrets sur l'économie de la redistribution des richesses, de se renseigner sur la façon dont le chômage fonctionne... pour nuancer son jugement"? Allons...)
Ar Soner a écrit:
Bien entendu (et je ne crois pas avoir jamais dit le contraire, là encore)
Tu ne dis pas le contraire mais en choisissant dans ton exemple de pointer Greepeace du doigt plutôt que le lobby du nucléaire, tu fais un choix qui n'est pas neutre et, par la force des choses, tu "asymétrises".
.
Citer:
La différence se situe probablement dans le fait que si le lobby du nucléaire a certainement le bras long en haut lieu, chez les politiques, au sein de la société civile c'est principalement la culture anti-nucléaire qui prédomine. Je tombe régulièrement sur des publications de Greenpeace sur mon mur Facebook, mais en revanche, je n'y ai jamais vu de message pro-nucléaire...
Sauf que ce que tu prends pour des réactions de gens qui n'y connaissent rien au nucléaire et qui seraient donc contre juste par principe, est en fait aussi à mon sens très souvent politique, même si les gens ne le verbalisent pas forcément comme ça. Ils se font une autre idée du monde, déplorent souvent la façon très anti-démocratique dont le nucléaire nous a été mis dans pattes à partir des années 50, regrettent qu'une bombe potentiellement terriblement mortelle se situe à quelques pas de leur maison, etc. Ce qui me semble finalement tellement "rationnel", pour reprendre tes mots...
Citer:
Cela étant dit, si tu veux un autre exemple, tu peux considérer les associations "anti-ondes" type Robins des Toits ou les comités anti-Linky. Leur communication est le plus souvent dramatiquement mauvaise, alignant les poncifs pseudo-scientifiques (alors qu'il y a de très bons arguments économiques ou sociaux à opposer à la 5G ou au Linky). Pour moi, là aussi, c'est de la désinformation et je ne vois pas trop comment on pourrait objecter du contraire.
Mais bien sûr qu'on peut objecter le contraire, et avec des arguments sensés en plus. (J'ai toujours un peu de mal avec le discours qui sous-entend qu'il ne faudrait pas questionner ce qui est considéré par certain-e-s comme des vérités immuables. Heureusement encore, qu'on a le droit de réfléchir et de déconstruire les discours). Or, en vrac, la question des faibles doses, des durées d'exposition, des interactions, du décalage entre le temps de la science et celui de la société, peuvent très légitimement permettre de questionner ce que certain-e-s prennent pour des certitudes absolues alors que les choses peuvent toujours évoluer, bouger. Scoop: c'est même précisément à ça que sert la science: faire bouger les lignes et faire avancer la connaissance. Et ce n'est pas en restant drapé dans des certitudes que ça marche (d'après moi). Tous les dossiers sujets à controverse en santé et environnement sont à regarder sur un temps long. Et quand on le fait, on voit bien que leur trajectoire n'est pas linéaire du tout et que ce qui pouvait être considéré comme dangereux hier peut ne plus l'être aujourd'hui... mais le redevenir demain! (En gros et pour le dire très vite).